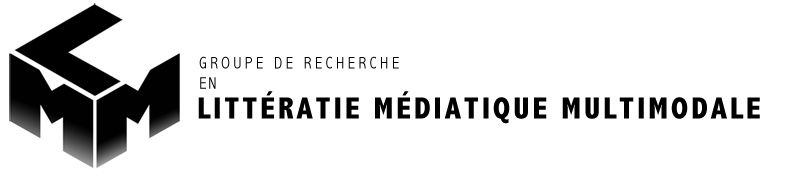15es Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature
Les temps et les lieux de la lecture « Apprendre à lire a été, pour moi, une des choses les plus faciles et les plus difficiles. Cela s’est passé très vite, en quelques semaines; mais aussi très lentement, sur plusieurs décennies. » Agnès Desarthe (2013)[1] Malgré d’une part les précieux éclairages apportés par les sciences cognitives et la sociologie, et d’autre part les avancées dans le domaine de la didactique, l’apprentissage de la lecture dans ses différentes composantes et la manière dont se développent à la fois le gout de lire et les compétences nécessaires pour construire du sens lors de l’activité de lecture demeurent en partie un mystère qui s’inscrit au cœur de l’histoire personnelle et scolaire de chaque individu. Notre parcours de lecteur se vit dans la durée et il est jalonné de temps et de lieux significatifs. À l’instar du témoignage livré par Agnès Desarthe dans son récent Comment j’ai appris à lire, nombreuses sont les autobiographies de lecteurs célèbres ou anonymes qui rendent compte de la diversité de ces expériences fondatrices et des multiples occasions d’épiphanie que représentent la rencontre avec certains textes en un temps ou un lieu précis ainsi que les interventions décisives d’un proche ou d’une personne enseignante. Pour Henry Miller, les premiers souvenirs de lecture constituent de fait des « évènements de notre vie »[2] qui mêlent monde intérieur et extérieur. Bien que circonscrite initialement dans le temps et dans l’espace, la rencontre avec un texte peut habiter longtemps le lecteur. Les images générées par la lecture ainsi que le sens qu’on leur attribue cheminent durablement dans nos esprits. Ce sens évolue au fil des expériences vécues qui entrent en résonance avec le contenu des lectures. On peut penser en ce sens qu’on n’a en quelque sorte jamais fini de lire certains textes. L’institution scolaire (« de la maternelle à l’université », pour reprendre la formule consacrée), joue un rôle crucial dans l’histoire des lecteurs car elle demeure, pour une partie importante d’entre eux, le premier, le principal sinon le seul lieu d’initiation, d’incitation et de pratique de la lecture de la littérature. Mais l’école ne fonctionne pas en vase clos et le rapport à la lecture se développe dans les milieux de vie avant les premiers apprentissages formels. Il se développe aussi à travers les expériences de lecture extrascolaires qui amènent à explorer d’autres temps et lieux de lecture. La prise en compte des pratiques extrascolaires de lecture qui se modifient en partie au fil de l’évolution des technologies représente un défi important pour les personnes enseignantes qui ne peuvent les ignorer. Que les lectures se déroulent dans l’espace-temps scolaire ou extrascolaire, par « l’activité fictionnalisante » (Langlade et Fourtanier, 2007)[3] qu’ils génèrent chez les sujets lecteurs, les textes de fiction permettent par ailleurs d’entrer dans des temps et des lieux inédits : des origines de l’humanité aux temps futurs, du ventre de la baleine à une planète lointaine…. C’est sans doute en partie ce « ressort » de la fiction qui pousse à lire et donne envie de découvrir de nouveaux univers à travers la fréquentation des œuvres littéraires. Dans le contexte scolaire, le temps et le lieu constituent des catégories traditionnellement utilisées dans l’analyse des récits. Comment ces catégories sont-elles ou peuvent-elles être traitées aux différents niveaux de la scolarité, en particulier lorsqu’il s’agit de faire lire des textes qui jouent avec les frontières du temps et de l’espace et présentent des défis particuliers de compréhension? Organisées par le Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture (Collectif CLÉ) en collaboration avec la section québécoise de l’Association internationale pour le développement de la recherche en didactique du français (AIRDF) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), les quinzièmes rencontres s’adressent aux chercheurs, aux formateurs, aux enseignants et aux bibliothécaires. Elles ont pour objectif d’interroger les manières dont les enseignants des différents ordres d’enseignement permettent à leurs élèves et étudiants, dans un contexte de langue première, seconde ou étrangère, « d’entrer dans les temps et les lieux de la lecture », réels et imaginaires, et de vivre des expériences significatives de lecture. Cela suppose de porter attention entre autres aux dispositifs mis en œuvre dans les classes et les établissements scolaires ainsi que dans les lieux périphériques, aux pratiques de familiarisation et d’exploitation des lieux institutionnels de la lecture (coins lecture, bibliothèque de classe, bibliothèque municipale, bibliothèque virtuelle…), à la programmation des activités autour des lectures, à leur répartition et à leur finalité selon les trois temps de la lecture (avant-pendant-après) distingués par Giasson (1995), aux progressions anticipées selon les différentes étapes du cursus scolaire, au choix des corpus et des supports, aux modalités d’analyse des œuvres lues, aux différentes formes d’engagement des élèves et étudiants dans les activités de lecture, et à la prise en compte de leurs pratiques de lecture qui s’effectuent en dehors de l’espace-temps de l’école. Axes des communications Les questions traitées dans les communications pourront être examinées soit sous l’angle des intentions et des pratiques des professionnels de la lecture (bibliothécaires, animateurs…) et des enseignants (Axe 1), soit sous l’angle des perceptions et des pratiques des élèves et étudiants (Axe 2). L’axe 3 rassemblera les communications centrées sur la manière dont sont évoqués au sein des œuvres littéraires (albums, romans, essais, autobiographies…) les temps et les lieux des lectures scolaires. [1]Desarthe, A. (2013). Comment j’ai appris à lire. Paris : Stock. [2] Miller, H. (1957). Ils étaient vivants et ils m’ont parlé. Les livres de ma vie. Paris : Gallimard. [3] Langlade, G. et Fourtanier, M.-J. (2007). La question du sujet lecteur en didactique de la lecture littéraire. Didactique du français, Les voies actuelles de la recherche, E. Falardeau et al. (dir.). Québec : Les Presses de l’Université Laval, 101-124.